
Religion et science-fiction: le modèle ''Battlestar Galactica''
«Sans en être totalement absentes, la religion et la théologie sont des champs qui sont relativement peu investis par les formes contemporaines de fictions», est-il écrit en ouverture de l'ouvrage collectif Theologia galactica pour aussitôt préciser: «Un tel constat ne tient pas devant les œuvres de science-fiction qui abondent en références théologiques et religieuses». Ces questionnements «parfois explicites, parfois implicites», expliquent deux des éditeurs (Franck Damour et David Doat) «ne sont pas du tout le fait d'auteurs marginaux: Olaf Stapledon, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, Stanislas Lem, Greg Bear, Dan Simmons, Pierre Bordage, Frank Herbert, Ray Bradbury, Orson Scott Card… la liste semble infinie de ces auteurs majeurs du genre qui ont explicitement assumé ces questionnements théologiques et spirituels». C'est à l'analyse d'une double série télévisée américaine (1978-1979 puis 2003-2009) qu'est consacré l'article de Renaud Rochette (IREL, EPHE-PSL, Battlestar Galactica, La Providence dans l'espace) dans cet ouvrage qui reprend une bonne part des interventions au colloque Science-fiction, religions, théologies, à Lille les 10 et 11 juin 2022.
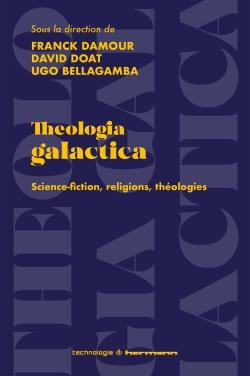
Pour Renaud Rochette (qui est de nombreuses fois intervenu à l'IREL sur les religions de fiction), «quand il est question de religion dans la science-fiction, il est difficile de ne pas évoquer 'Battlestar Galactica' tant les éléments religieux y occupent une place importante». Dans cette série qui narre la lutte entre les humains (originellement installés sur 12 planètes mais dont une partie cherche à rejoindre la Terre) et des humanoïdes, cherchant à les détruire, les Cylons, «les éléments religieux jouent à trois niveaux».
La religion est d'abord «un élément de construction du monde imaginaire» puisque «des religions sont présentes dans les sociétés des Douze Colonies et des Cylons»: dans une volonté de «décalage» avec la science-fiction grand public de type Star Trek (série sur laquelle Ronald D. Moore, l'un des concepteurs, «a passé 10 ans à travailler») et les «motifs un peu fantaisistes liés au genre» comme «aliens, technologie incompréhensible, jargon technique, situations improbables», la série se veut «naturaliste» afin de «ne pas servir à créer de l'exotisme et de l'altérité, mais permettre une analyse du monde contemporain». Une analyse à fronts renversés puisque «les Douze Colonies» (société qui «ressemble énormément à la société américaine du début du 21e siècle») «sont une société polythéiste» tandis que les Cylons «adhèrent à un monothéisme suffisamment vague et fluide pour qu'on puisse y reconnaître n'importe quelle religion abrahamique». Si «ce choix a une portée limitée pour le public européen», pour «des spectateurs américains, voir des personnages qui leur ressemblent être païens tandis que les ennemis de l'humanité croient au seul vrai Dieu peut être troublant».
La religion est ensuite «un élément du récit: les croyances des personnages ont une incidence sur le développement de l'intrigue». Si chaque camp est caractérisé par une religion dominante, les personnages ont des parcours individualisés: certains humains et Cylons sont athées, agnostiques ou sceptiques, d'autres «profondéments croyants», une «variété dans le rapport aux croyances religieuses» qui «permet de montrer que la religion peut être utilisée comme un levier pour manipuler les personnages» ou leur ambivalence en la matière comme Laura Roslin qui s'assimile de bonne foi au personnage d'un livre sacré tout en affirmant «jouer la carte religieuse» pour en «tirer un bénéfice politique». Mais lorsque la Terre (objectif salvateur) «se révèle être totalement contaminée par la radioactivité, elle connaît une grave crise personnelle, qui est aussi une crise de foi, pour avoir mené la Flotte dans une impasse».
La religion est enfin «une stratégie narrative: les conceptions qui structurent les croyances des Coloniaux et des Cylons permettent au spectateur de s'immerger dans l'univers de 'Battlestar Galactica' et sa logique, afin de lui faire admettre qu'une forme de providence divine guide les personnages vers leur destin». C'est l'aspect (lié aux «croyances mormones» du concepteur de la première série, Glen A. Larson) qui a suscité des contestations, par exemple de la part de George R.R. Martin qui, dans une «critique au vitriol» en 2009, «considère que les règles élémentaires de la narration sont bafouées par le recours à ce genre de manœuvres». En effet, malgré la «logique réaliste», «des éléments surnaturels sont pourtant progressivement réintroduits jusqu'à recourir à une intervention divine pour permettre à l'humanité de trouver une planète où s'établir». Mais on est loin du salut universel puisque tout «repose sur une vision pessimiste d'une humanité répétant constamment les mêmes erreurs» et donc «l'idée d'une histoire circulaire qui se répète sans fin», d'où l'utilisation de la chanson All Along the Watchtower de Bob Dylan (1967) et de son premier vers («There must be some kind of way out of here», Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici) au moment où l'on découvre les coordonnées de la «nouvelle Terre»...
En plus de l'introduction des éditeurs (accompagné en contrepoint de la reprise de l'article publié en 1968 par Christine Renard-Cheinisse sur Les problèmes religieux dans la littérature dite de science-fiction), l'ouvrage comprend quatre parties (La SF comme quête, Au sujet du théologico-politique, Distorsions temporelles et autres catastrophes, Le ciel vide de la SF) et 19 articles dont entre autres un entretien avec Pierre Bordage (auteur de la série Les Guerriers du silence), des études de Vincent Gossaert (EPHE-PSL, Culture religieuse et représentation de l'autre en science-fiction et fantasy) et Johan Rols (GSRL, CRCAO, À la croisée des mondes: «Culture de soi» taoïste, science-fiction et jeux vidéo dans la web-littérature chinoise) et des objets ou auteurs aussi connus que Star Trek (Jessica Lombard), Frank Herbert (Fabrice Chemla), Philip K. Dick (Paul Jorion) ou Lovecraft (Camille Byron).
Franck Damour, David Doat et Ugo Bellagamba (éd.), Theologia galactica, Science-fiction, religions, théologies, Hermann (Technologia), mars 2025.

