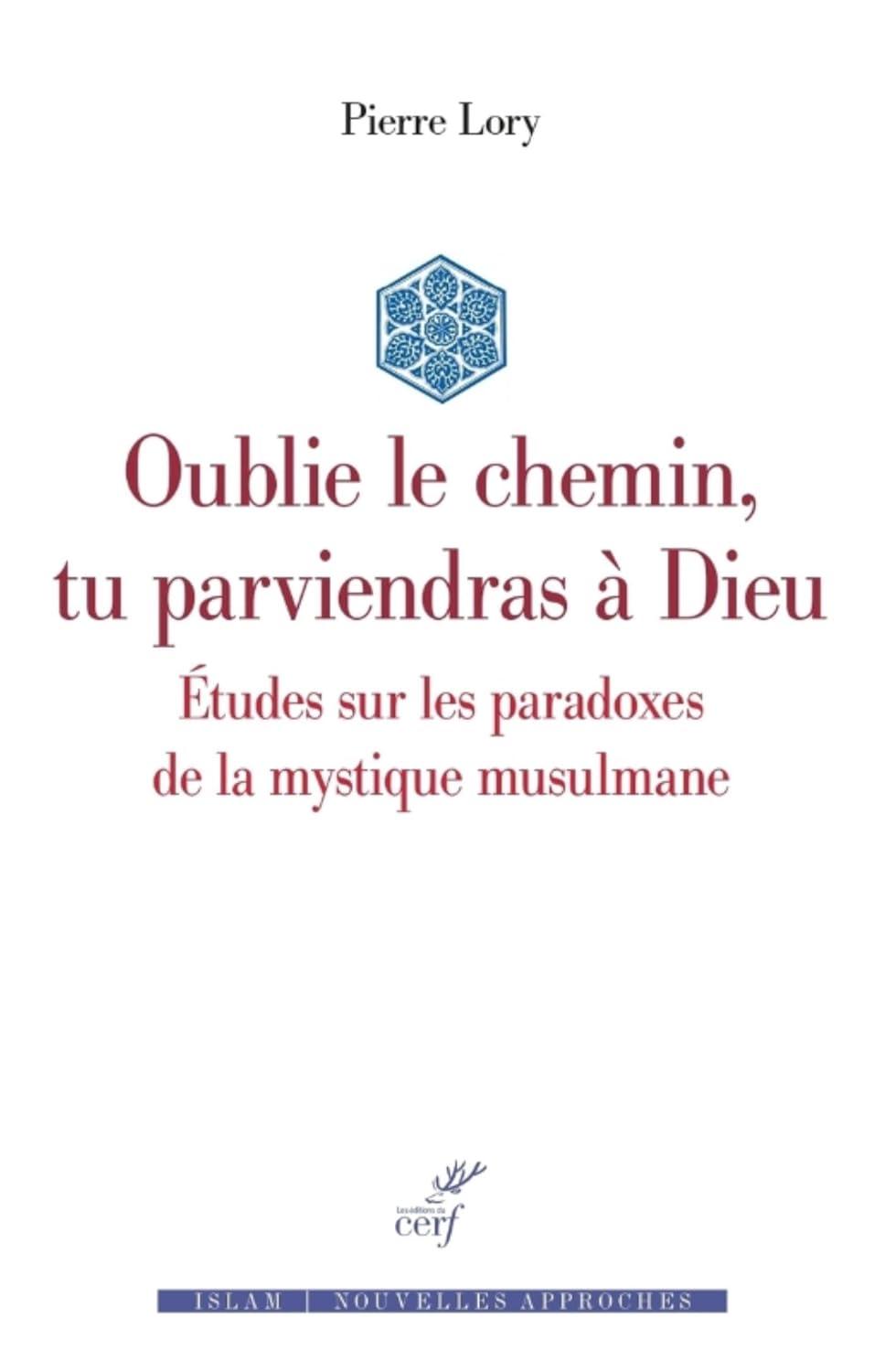
"Oublie le chemin, tu parviendras à Dieu": Mercredi de l'IREL avec Pierre Lory
Le prochain Mercredi de l'IREL le 7 mai sera une rencontre à l'IISMM (MSH Raspail, Paris) avec Pierre Lory à propos de son livre Oublie le chemin, tu parviendras à Dieu, Études sur les paradoxes de la mystique musulmane, en débat avec Ève Feuillebois-Pierunek (Université Sorbonne Nouvelle, LEM).
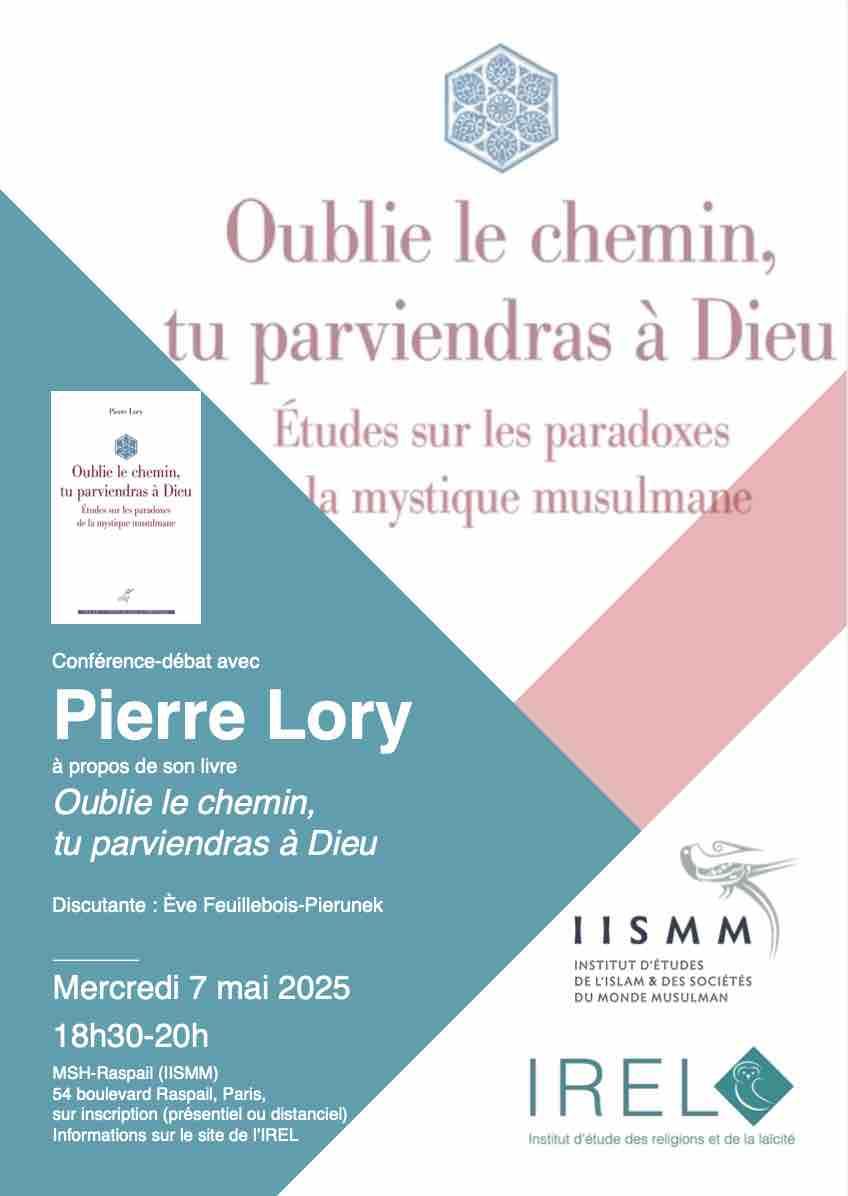
Télécharger la présentation du Mercredi de l'IREL avec Pierre Lory
« La littérature mystique des premiers siècles de l’Islam fait état de propos étranges de plusieurs de ses grands représentants, comme « Oublie le chemin, tu parviendras à Dieu ». Ces énoncés surprenants ont le plus souvent été réduits par les commentateurs à des expressions extatiques marginales.
Or, c’est l’essence même de la mystique musulmane qui est saisie dans ces paradoxes. Il y est question de passion pour un Aimé radicalement inconnu ; de contemplation d’un Être invisible et, enfin, d’anéantissement complet dans une totalité immatérielle. En définitive, ces équivoques expriment la nature profonde du soufisme, à savoir la question du sujet humain: qui croit, qui parle, qui aime au terme du parcours mystique ?
Dans cet ouvrage aussi accessible que passionnant, Pierre Lory nous montre comment l’islam a pu dire Dieu qui se rapproche de l’homme ; comment cette improbable rencontre se lit dans le Coran, comment elle se lit aussi dans la nature et, enfin, comment elle se traduit dans la mystique. »
Pierre Lory est directeur d’études émérite à l’EPHE (Mystique musulmane), diplômé de Sciences Po Paris et de l’Inalco en langue et civilisation arabes, agrégé d’arabe. Sa thèse (1981) porte sur l’œuvre de Jâbir ibn Hayyân et a été suivie d’un doctorat d’état (1991). Maître de conférences en langues et civilisations arabes à l’Université Bordeaux III puis directeur d’études à l’EPHE (1991 à 2021) après plusieurs années de recherches au Proche-Orient, il a poursuivi des travaux sur la mystique et les courants de pensée ésotéristes en Islam classique. Directeur scientifique du département des études arabes, médiévales et modernes à l’IFPO (Damas) de 2007 à 2011, il est membre du LEM et secrétaire de l’Association des Amis de Henry et Stella Corbin.
Ève Feuillebois-Pierunek est maître de conférences (avec habilitation à diriger des recherches) de littérature persane et d’islamologie au département d’Études orientales de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris III, et membre du LEM. Elle a publié en 2021 (également aux Éditions du Cerf) : De l’ascèse au libertinage: les champs de la poésie mystique persane.
La rencontre, ouverte à tous, a lieu à l'IISMM (MSH, 54 boulevard Raspail, Paris). Un lien de connexion sera envoyé le mercredi 7 dans l'après-midi à toutes les personnes inscrites.
Lire la notice sur le site des éditions du Cerf
S'inscrire pour participer en présence ou à distance
Les «paradoxes», «nature profonde» de la littérature soufie
(Résumé de l'introduction et du post-scriptum)
La tradition sunnite en parle comme de «débordements» (shatahat), l'islamologue Henry Corbin comme des «paradoxes mystiques». «Surtout diffusés au cours des premiers siècles de l'ère musulmane» et «plutôt sévèrement jugés à partir des 11e-13e siècles», ces «paradoxes de la mystique musulmane» qu'étudie Pierre Lory dans son dernier livre témoignent pour lui chez les soufis qui en sont les auteurs «d'un changement 'définitif' dans la 'perception' même de leurs sens, et de l'usage de leur entendement». Car «à la conscience ordinaire du croyant opposant 'moi' à 'Dieu', 'moi' au 'monde', le 'monde' à Dieu, le shath exprime une perception unitive, où la conscience universelle divine assume celle des hommes et des autres créatures. La dualité est dépassée, pour accéder à l'unification (tawhid) complète des foyers de conscience. Et ceci ne peut se dire que de façon paradoxale».
Pour Pierre Lory (et c'est la thèse qu'il défend dans cet ouvrage), «les paradoxes dits shatahat ne sont pas un chapitre marginal de la littérature soufie», mais au contraire, «ils en expriment la nature profonde, à savoir la question du sujet humain : 'qui' croit, 'qui' parle, 'qui' aime au terme du parcours mystique ? La formulation des shatahat ne fait que condenser jusqu'à l'extrême les témoignages de l'essence même du vécu mystique» et il ne s'agit donc pas de «simples moments d'extase» comme les a ensuite qualifiés l'orthodoxie soufie.
Pour les premiers soufis, qui représentent une «troisième démarche exegétique» en islam sunnite «parallèlement au courant rationaliste et à celui des littéralistes» (qui va bientôt triompher), tout ce qui apparaît dans le monde sensible «peut être support de présence divine», avec l'idée que «Dieu Se voile en Se révélant, car les hommes ne pourraient pas supporter une révélation directe de son Être. Simultanément, Il Se révèle en Se cachant, selon une succession indéfinie de ''ruses'' divines à l'égard de ceux qui Le cherchent», «paradoxe qui est à l'origine de l'attitude» de ces premiers soufis et «la matrice de tous les questionnements» étudiés dans le livre.
Des questionnements (des «équivoques divines») que Pierre Lory étudie en quatre parties correspondant à «quatre zones du savoir de l'islam médiéval»:
Premièrement les «paradoxes mystiques» au «sens précis des shatahat»: «locutions énigmatiques et parfois provocantes» (la Kaaba comme «idole dans laquelle Dieu n'est ni présent ni absent», selon Rabi'a au 8e siècle) rassemblées dans une tradition propre pour tenter «d'élaborer une synthèse du cheminement sur la voie mystique».
Deuxièmement, les «paradoxes dans les exégèses coraniques» en se focalisant sur «les passages apparemment difficiles ou équivoques du texte sacré» vus comme des «paradoxes énoncés par Dieu», notamment dans les histoires «des messagers divins dont Muhammad se réclame».
Troisièmement, les «paradoxes cosmiques» à «la lecture du grand livre de l'univers» qui «possède lui aussi un sens apparent – et un sens caché»: «les autres créatures dans le monde sont autant de messages à comprendre, d'énigmes à résoudre, de modèles à suivre éventuellement». Chaque créature consciente non humaine (anges, djinns, animaux) «rappelle à la conscience humaine l'énigme de sa propre vocation à exister».
Enfin quatrièmement, «l'alchimie» qui s'emploie «en culture musulmane» à «explorer le mystère de l'évolution du monde minéral», qui est «la partie la moins consciente et donc la plus docile au vouloir créateur divin». À la fois «recherche spirituelle et travail scientifique», la riche littérature qui nous en est restée «s'exprime pour ainsi dire structurellement en paradoxes».
En «post-scriptum», Pierre Lory note que «les différents paradoxes qui transparaissent à chacun des chapitres convergent vers une certitude commune: c'est une conscience divine transcendantale qui anime, oriente et 'constitue' même la conscience particulière des hommes comme Moïse, Bastami, Hallaj, Shibli; mais également la conscience des anges, des animaux, des djinns, sans oublier les minéraux, ces purs miroirs des volitions divines». Le «caractère orthodoxe» de cette «expérience à jamais rebelle à toute expression théologique» devra ensuite être expliqué et justifié par «une partie importante de la littérature soufie». Mais «les premiers grands soufis avaient sans doute devancé le danger», qui, comme Hallaj, appelle ses «fidèles amis» à le tuer car «c'est dans mon meurtre qu'est ma vie. Ma mort, c'est de vivre et ma vie, c'est de mourir». Demande exceptionnelle qui est un «paradoxe en acte: de même que la vérité est paradoxale et peut s'affirmer avec son contraire, de même la sainteté peut-elle s'accomplir en suscitant sa propre condamnation». «Comme l'a suggéré Louis Massignon», Hallaj semble «avoir accepté son exécution par fidélité à sa communauté», ne voulant pas «taire le témoignage de sa vie mystique» mais ne voulant pas non plus «dénoncer le dogme de l'islam sunnite commun». «La grande majorité des soufis», conclut Pierre Lory, préféra «se confier à une attitude de prudent ésotérisme. Mais ce ne fut pas le cas de tous».

